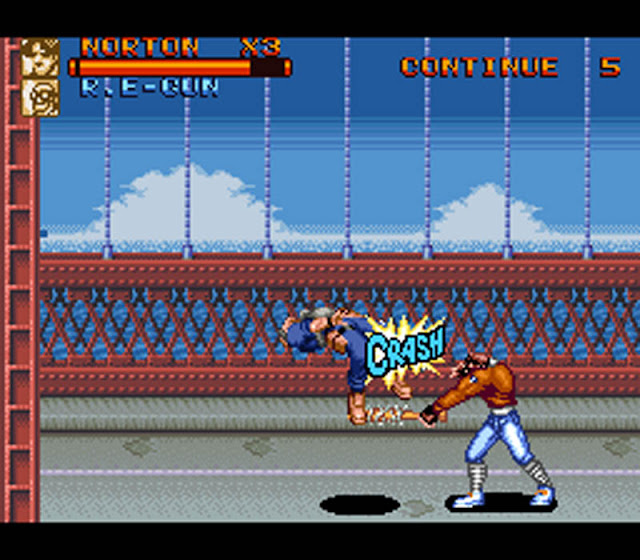Viewpoint (Sammy)
Test rapide de Viewpoint sur: Neo Geo (1992, Sammy)
Sortie originale: Arcade (1992, Sammy)
___________________________________________________________________________
Un chef d'oeuvre intemporel, un must have de la console, une référence incontournable...
Voilà ce qu'est Viewpoint pour une bonne partie des amateurs de Neo Geo; j'en connais même qui l'emmèneraient dans la tombe tellement ils l'adorent, ce jeu.
 |
| Je crois ne pas me gourer en disant que c'est un des tous premiers jeux à utiliser aussi massivement le pre-rendering. |
Le net foisonne de tests allant dans ce sens; pour y lire tout ce qu'il y a à aimer dans ce jeu, vous pouvez par exemple lire ceux de:
ou
Manque de bol pour moi qui misais dessus pour me délivrer mon fix de gros shoot qui tache, mon ressenti est complètement différent.
Je le livre ici non pas pour pisser sur un jeu que beaucoup adulent, ni pour prendre un contre-pied malin, ni pour remettre en cause tout le bien qui en est dit par ailleurs - mais juste parce que je ne veux pas croire que ce jeu plaise à tout le monde. Il faut bien que de temps en temps un bouseux poste un avis négatif en guise de mise en garde: Viewpoint, je pense que ce n'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Et en l'occurrence, ça n'en était pas un pour moi.
 |
| Il n'y a qu'une seule arme: un tir qu'on peut charger. Et trois bombes différentes. |
Pour deux raisons qui n'ont a priori rien à voir, mais qui, le concernant, me paraissent étroitement liées: je pense que pour ne pas être rebuté par la conception du jeu, il faut qu'on soit franchement enthousiasmé par son esthétique - qui est, il faut bien le dire, un petit peu particulière elle aussi.
 |
| Les sprites de ce niveau sont des captures de poissons polygonaux. Particulier. |
Les fans du jeu l'ont deviné, ce qui m'a franchement cassé les testiboules, c'est la difficulté du jeu.
Mais ce n'est pas tant à quel point Viewpoint est difficile, que comment il est difficile, qui m'a gavé.
Dans Viewpoint, le challenge, ce sont les bosses. Non pas que le reste soit une promenade - mais ce qui vous fait recommencer encore et encore, ce sont les bosses, et leurs formes successives. Les niveaux, à force de les refaire pour revenir aux bosses, vous les one-lifez régulièrement...
 |
| Le premier boss est un hover-zguègue. A noter que le jeu arrose à la boulette rose, peu commune à l'époque. |
De sorte que passé un certain cap, on ne fait plus que cela: recommencer sans cesse pour ancrer, tant au bout de ses doigts qu'à l'arrière de son cervelet, le schéma qui permet de battre un boss... Avant de se mettre en route pour mémoriser le suivant.
Une fois que j'ai compris ça, je me suis regardé faire un énième recommencement, tapoter frénétiquement le bouton A pour arroser l'écran de tirs, faire ralentir le jeu et mieux slalomer entre les boulettes du 3e boss... Et je me suis dit que je me faisais bien chier, quand même.
Et que la perspective d'avoir le droit de faire le même genre de conneries, mais en pire, au boss suivant, c'était quand même pas une motivation bien satisfaisante.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut bien être assez maso pour s'infliger une purge pareille?
Moi, en l'état, je ne vois que deux possibilités:
- on adhère au concept de boss fights façon "Un jour sans fin".
- on est captivé par l'esthétique du jeu.
 |
| Ploup-ploup-ploup, font les bulles. |
Honnêtement, je pense que c'est le deuxième cas qui est le plus fréquent. Il doit falloir avoir connu le jeu à l'époque, ou ressentir la nostalgie des années badge acid, Rock To The Beat et Benny B, ou bien alors être un peu drogué soi-même pour apprécier les musiques aux mélodies planantes, mais aux sonorités sévèrement décadentes qui accompagnent le slalom du vaisseau entre les boulettes... Et plus encore l'environnement graphique - qu'il s'agisse de la technique employée, ou des thématiques des niveaux...
Je ne sais pas ce que c'est son histoire, à Viewpoint, mais il ressemble à un de ces jeux qui ont commencé comme démo technique avant qu'un éditeur ne dise aux deux chevelus qui l'ont pondue: "hé, c'est super, ça, les cocos! Maintenant signez-là, prenez un cigare, et faites m'en un jeu, de votre truc.". En tout cas, esthétiquement, on peut dire que c'est peu commun, éclectique et sans concessions. Graphismes et musiques ont été récompensés à de multiples reprises à l'époque, et continuent à faire l'admiration des fans. Là encore, je me sens parfaitement exclu du truc: cet engouement pour les poissons, insectes, et ressorts polygonaux qui dansent sur des tuiles ternes au rythme de basses de synthé, je le comprends aussi bien que la poule face au couteau.
Comme quoi des fois on passe à côté de trucs qui ne nous ont pas attiré pendant des années, on les redécouvre sur un tard et on hurle au génie.
Et d'autres fois y'a rien à faire.
On m'a dit que j'y reviendrai un jour. Pour l'instant, ça ne me démange pas.
 |
| Mon avis: un jeu à essayer longuement avant de l'acheter sur l'une de ses nombreuses recommandations. |